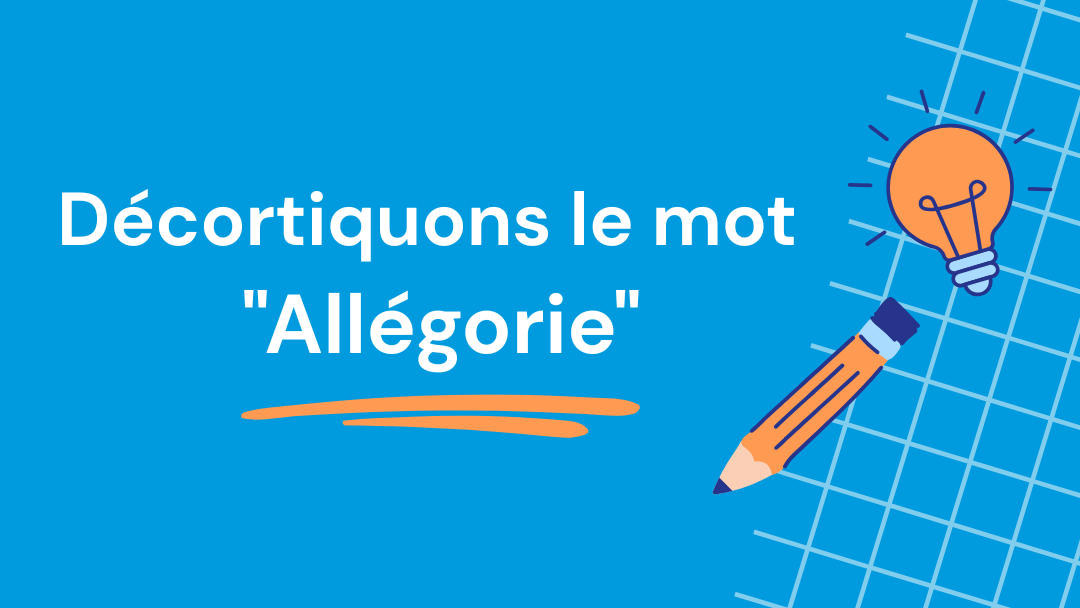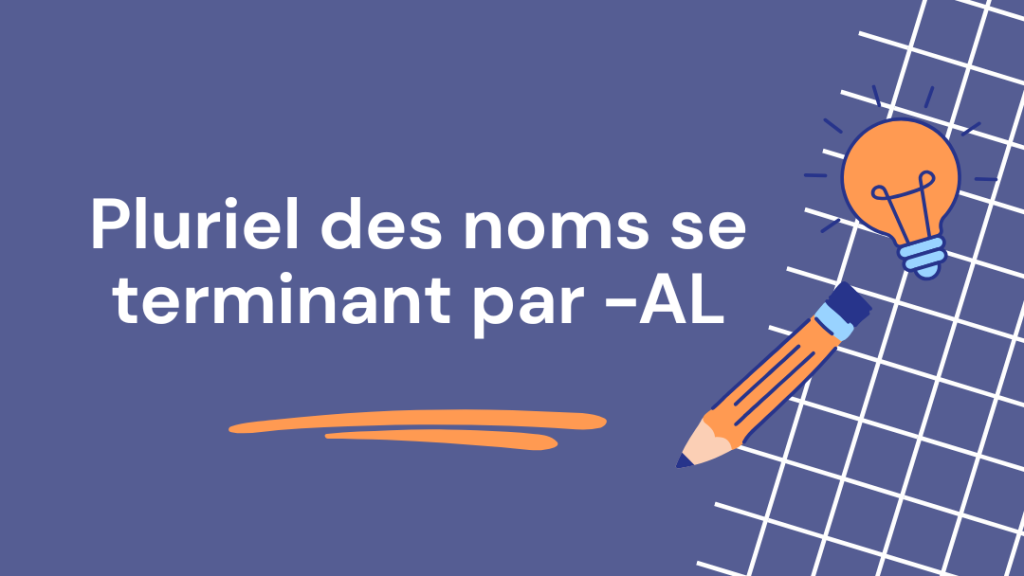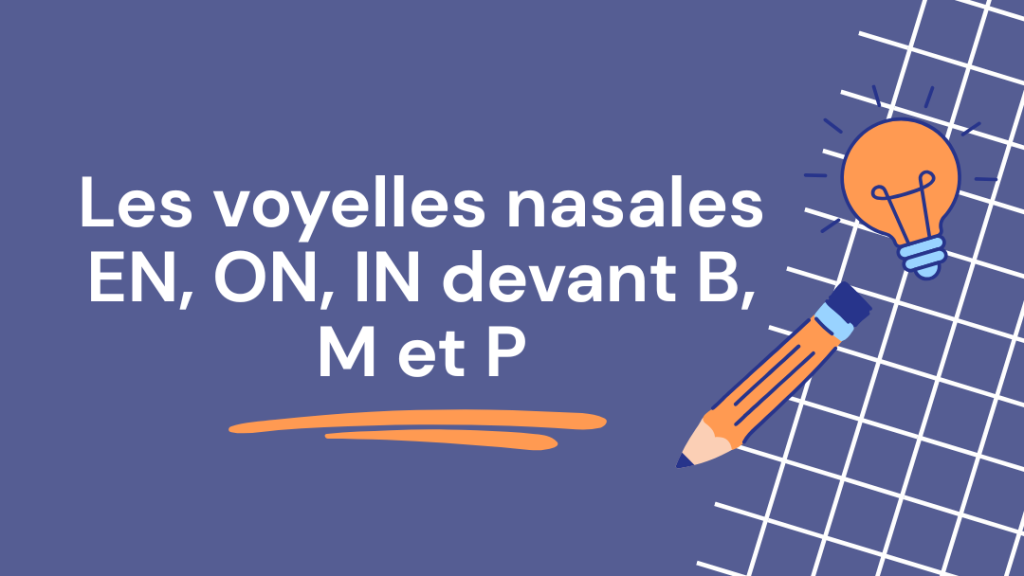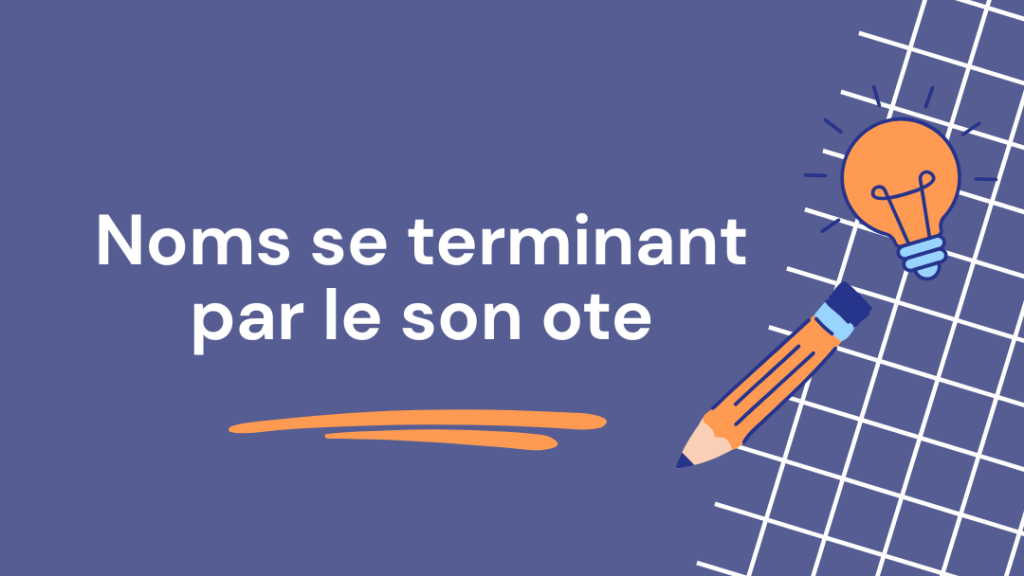Allégorie : quand les idées prennent forme
Le mot allégorie vient du grec allegoria, formé de :
allo = autre, différent
agoreuein = parler, dire
Allégorie signifie donc littéralement : « autre manière de parler ».
C’est ce qu’elle fait : elle représente une notion abstraite à l’aide de figures concrètes, souvent personnifiées.
Par exemple, la justice ne peut pas être dessinée directement.
On la figure alors par une femme avec une balance et un glaive :
c’est l’allégorie de la justice.
Des exemples pour tout comprendre
L’allégorie permet de donner une forme visuelle à ce qui est immatériel :
la liberté, représentée par une femme tenant un drapeau (comme dans La Liberté guidant le peuple) ;
la mort, souvent figurée sous les traits d’un squelette armé d’une faux.
On parle alors de personnification d’une idée abstraite.
Orthographe
Le mot allégorie commence par all-, avec deux L.
Pour s’en souvenir, on peut se référer à son étymologie grecque, qui contient aussi ce double L.
Dans la même famille
Le préfixe allo- (autre) a donné :
allochtone : « issu d’un autre territoire »,
allogreffe : « greffe venant d’un autre corps »,
allophone : « personne dont la langue maternelle est différente de celle du pays où elle vit ».
Proches d’allégorie :
- allégorique (adjectif) : représentation allégorique
- allégoriquement (adverbe) : exprimé allégoriquement
A retenir
Allégorie signifie « autre manière de dire ». Elle sert à figurer une idée abstraite par un personnage ou un objet concret. Elle relève de la personnification symbolique. Le mot s’écrit allégorie, avec deux L. De la même famille : allégorique, allégoriquement, mais aussi allochtone, allophone, allogreffe.