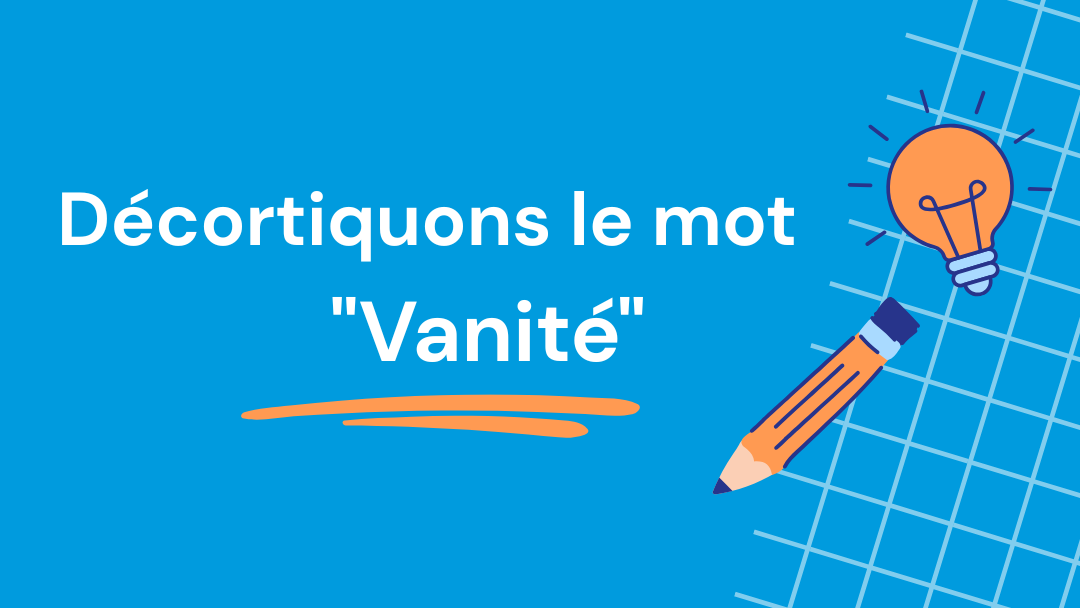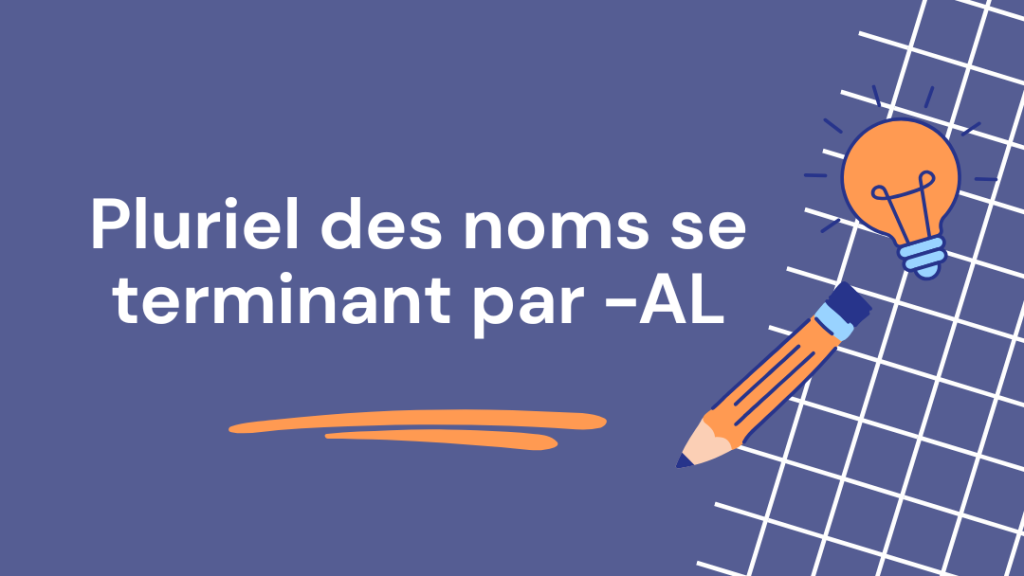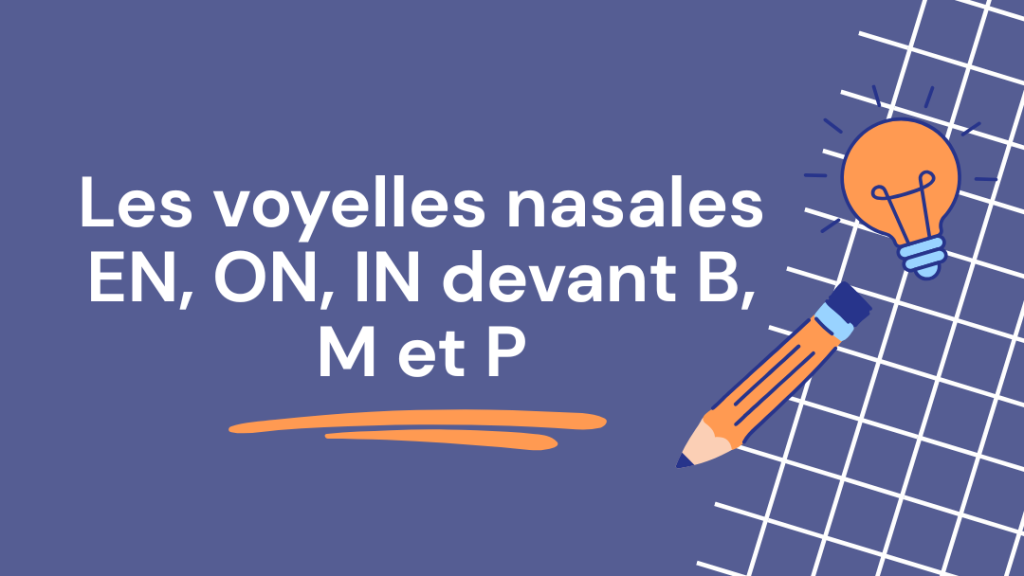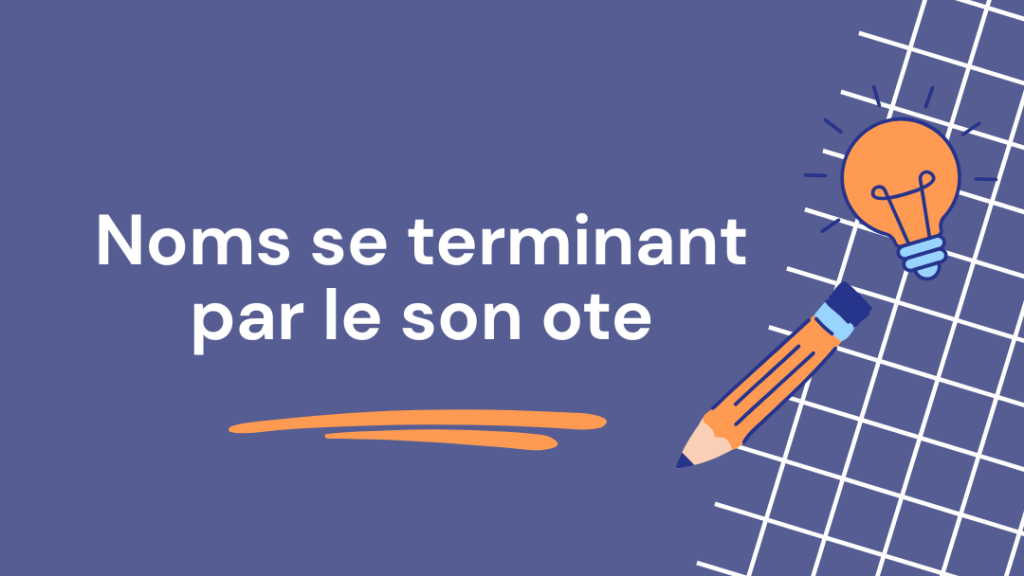Vanité : origine, sens et famille
Le mot vanité vient du latin vanitas, lui-même issu du latin vanus (qui a donné vain).
Vain signifie « vide », au sens propre comme au sens figuré. Aujourd’hui, c’est surtout le sens figuré qui prévaut : un raisonnement vain est un raisonnement creux, voire trompeur, mensonger.
Le sens a ensuite glissé vers la notion d’inefficacité, d’inutilité (un combat vain, un effort vain), pour arriver au sens de « prétentieux, vaniteux, orgueilleux » (on parle d’un vain personnage).
Le mot vanité possède les mêmes sens et est principalement employé aujourd’hui comme synonyme d’orgueil.
Il peut aussi désigner ce qui est insignifiant, futile, illusoire.
Des exemples pour tout comprendre
Tirer vanité de quelque chose : s’enorgueillir de quelque chose, se glorifier.
Ex. : Il tire vanité de sa réussite aux jeux de hasard.
Sans vanité : « sans vouloir me vanter ».
Ex. : Sans vanité, c’est moi qui ai eu l’idée le premier.
Orthographe
Les mots féminins se terminant par la prononciation [te] et désignant des notions abstraites, des qualités ou des défauts s’écrivent -té, mais sans e final.
Exemples dans le champ lexical de la vanité :
fierté, futilité, fatuité, frivolité, inutilité, vanité.
Dans la même famille
- Vaniteux
- Vanity-case (mot à mot : valise à objets inutiles, souvent abrégé en vanity)
- Vain
- Vainement
- Vanter
- Vantard
- Vantardise
A retenir
Vanité vient de vanus, qui signifie « vide » : c’est l’idée de creux, d’illusion, d’orgueil. Elle peut désigner à la fois l’arrogance et ce qui est futile, sans importance. Elle est opposée à l’humilité, la modestie, la réserve. Expressions courantes : tirer vanité de, sans vanité. Les mots en -té désignant des défauts ou qualités n’ont pas de e final.